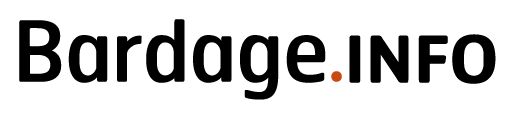En voici les principaux enseignements :
- Le réemploi est encore perçu comme flou et qu’il peut évoquer la contrainte notamment. Il faudrait alors plutôt parler de « seconde vie » ou encore de « reconditionné », termes perçus comme plus positifs et plus désirables.
- Le devoir environnemental est important mais les bénéfices concrets d’usage et d’image le sont aussi. Promouvoir une image enthousiasmante et innovante du réemploi est essentiel.
- Les catégories de matériaux face au réemploi sont inégales face au réemploi. Toutes ne sont pas perçues de la même manière. Les éléments inaltérables, comme la pierre ou le métal, sont plus facilement acceptés. À l’inverse, les matériaux techniques ou altérables soulèvent des interrogations, notamment en matière de santé, de performance et de conformité réglementaire.
- Le coût, la complexité du reconditionnement et les freins assurantiels renforcent la prudence des professionnels, surtout pour les matériaux invisibles, techniques ou à forte responsabilité tels que les isolants thermiques ou acoustiques.
- Deux formes de réemploi sont mises en lumière : l’une visible, revendiquée comme geste esthétique et patrimonial ; l’autre plus discrète, intégrée de manière fonctionnelle. Les deux ont leur rôle à jouer dans la transformation du secteur.
- Pour accélérer l’adoption du réemploi, plusieurs pistes : renforcer la fiabilité du réemploi par la certification, le rendre plus accessible via la massification, et nourrir son attractivité dans l’imaginaire collectif par des références concrètes, des ambassadeurs et une intégration systématique dans les marchés publics